La guerre d’Iran aura-t-elle lieux ?
Réseau Voltaire. Le 17 Juillet 2010 par Jean-Michel Vernochet
L’accord tripartite de Téhéran sur le nucléaire iranien provoquera t-il le conflit au lieu de résoudre la crise ? C’est ce que pense Jean-Michel Vernochet pour qui, les Etats-Unis n’ayant plus d’arguments pour justifier leurs sanctions contre l’Iran pourraient être tentés d’en finir en passant à l’acte. Bien sur, la guerre ne doit pas nécessairement être entreprise contre Téhéran, elle peut aussi éclater à sa marge pour l’y précipiter.
![]()

La guerre contre l’Iran aura-t-elle lieu ? Inutile de jouer les Cassandre, la réponse à cette question devant nous être donnée par les événements eux-mêmes. Par contre peut-être n’est-il pas vain de s’intéresser au rapport des forces en présence dans leur dynamique d’évolution. Nous parlons ici essentiellement de rapports de forces politiques tant la question semble réglée d’avance en ce qui concerne le différentiel de forces militaires en cas de confrontation directe entre Washington, Tel-Aviv… et Téhéran.
En effet, la disproportion entre le potentiel militaire de coercition des uns et celui des autres ne prête à aucune équivoque. De ce point de vue, ce sont exclusivement des paramètres de nature « politiques » qui déterminent avant tout, encore aujourd’hui, le gouvernement iranien à ne pas céder aux injonctions de la « Communauté internationale ». Aussi parce que Téhéran considère qu’il est loin d’avoir « épuisé » la carte de l’accord tripartite turco-irano-brésilien [1]. Celui-ci pouvant, le cas échéant, lui offrir une issue raisonnable (voire « honorable », ne pas perdre la face en Orient étant un souci premier). Rendez-vous est à ce propos pris avec Brasilia et Ankara pour la fin août…
Reste que le succès de cette entreprise de contournement de la diplomatie états-unienne est loin d’être assurée au vu des réactions violemment négatives des Anglo-Américains (voir infra). Surtout que, lorsqu’on parle de « négociation » avec Téhéran, encore faut-il bien entendre que l’on attend du gouvernement iranien une reddition sans condition. En contrepartie, Téhéran fera tout, et jusqu’au bout, pour éviter de passer sous les Fourches caudines comme le département d’État l’y convie avec une pressante insistance.
Mais de ce point de vue, tout n’est pas dit. D’abord parce que l’Iran se sait, en principe, totalement vulnérable « à une attaque instantanée et non détectable, écrasante et dévastatrice, sans possibilité de défense et sans capacité réelle d’exercer des représailles dissuasives » [2] ; ensuite parce que la Turquie trouverait dans l’aboutissement réussi de l’accord de Téhéran un moyen de s’affirmer sur la scène régionale tout en rendant la monnaie de sa pièce à Tel-Aviv après l’humiliation de l’épisode sanglant de la flottille humanitaire pour Gaza.
A contrario, d’autres facteurs ne plaident pas en faveur d’un règlement négocié par le truchement de la Turquie et du Brésil associés dans le sauvetage de l’Iran national-islamiste [3]. Russes et Chinois pratiquant, volens nolens, un jeu de bascule diplomatique, ont voté le 9 juin la Résolution 1929 du Conseil de Sécurité des Nations Unies durcissant le régime des sanctions internationales imposées à l’Iran [4]. Résolution qui surtout a donné caution au Congrès états-unien, puis à l’Union européenne – Bruxelles devant faire connaître son propre train de sanctions vers la fin du mois de juillet – pour prendre en concertation des mesures draconiennes à l’encontre de la République islamique, notamment d’ordre économique (voir infra).
En ce qui concerne Moscou, cette décision semble bien refléter une certaine « schizophrénie » au sommet de l’État ou un bicéphalisme ouvertement divergent entre une Présidence a priori plus « occidentaliste » que ne le serait le Premier ministre Vladimir Poutine. Cela se traduit à la fois par un ralliement âprement négocié à la politique de sanctions états-uniennes et européennes, et simultanément par des « consultations » irano-russes portant sur le renforcement de la coopération bilatérale ; certes « en premier lieu économique » comme l’a souligné récemment le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Alexeï Borodavkine… ou encore le maintien d’une complète ambigüité quant aux livraisons de batteries de missiles hypersoniques anti-aériens S300 (voir infra).
*****
Examinons maintenant quelques unes des raisons qui sont vraisemblablement intervenues Moscou pour décider le Kremlin à voter en faveur de la Résolution 1929, le 9 juin 2010, moins d’un mois après avoir applaudi à la conclusion de l’accord tripartite.
Passons sur la nécessité impérieuse, pour la Fédération de Russie, d’une réduction de la production afghane d’opium (dont les produits dérivés occasionnent quelque 30 000 décès annuels en Russie), et notons, par une heureuse coïncidence, la levée des sanctions états-uniennes contre quatre groupes russes réputés avoir commercé de façon « illégale » avec l’Iran et la Syrie après 1999.
Selon le Washington Post du 22 mai 2010, l’administration Obama – trois jours après l’annonce par la Secrétaire d’État, Mme Hillary Clinton, que la Russie acceptait d’avaliser le projet de résolution – abandonnait ses « poursuites » contre Rosoboronexport épinglé en 2006 et 2008 pour des ventes illicites à l’Iran ; également concerné l’Institut moscovite d’avionique, ainsi que l’université des sciences et techniques de la chimie Dimitri Mendeleyev pour transferts illégaux de techniques relatives au domaine balistique. Depuis janvier 2010, l’Administration Obama a su apparemment donner des gages substantiels et avait déjà opéré la levée préalable des sanctions frappant Glavkosmos et l’Université technologique de la Baltique pour leurs échanges avec l’Iran…
Mais pour qu’un marchandage soit complet, il faut aussi que certaines portes restent entrouvertes, ainsi l’Administration Obama, dans la formulation de son projet de résolution, a su maintenir un flou artistique quant à l’interdiction de le vente de systèmes de missiles hypersoniques sol-air russes S300 à l’Iran. Un marché représentant plusieurs centaines de millions de dollars, vraisemblablement en partie déjà payés, mais dont les livraisons ont été jusqu’à présent ajournées pour des « raisons techniques » sous la pression conjointe américano-israélienne. Passé en 2005 ce contrat concerne 30 à 40 systèmes d’armes (dont un aurait peut-être été livré en 2008), des matériels ayant la capacité de rendre l’Iran en grande partie imperméable à d’éventuelles frappes israélo-américaines… sachant que dix systèmes seulement suffiraient théoriquement à assurer la couverture des sites stratégiques perses, et ce, notamment contre une aviation israélienne aux performances limitées par une relative vétusté...
*****
À l’incartade turco-brésilienne, Washington avait aussitôt répondu en ignorant superbement l’accord tripartite signé la veille du dépôt de son propre projet de sanctions renforcées devant le Conseil de Sécurité. Un camouflet pour la Turquie et le Brésil remis à leur « juste » place dans le concert des Nations, dont le président des États-Unis monopolise le pupitre de chef d’orchestre. Des « signaux forts » ayant été envoyés à Ankara [5], il convenait de présenter à la Turquie une « carotte » assez appétissante pour l’inciter à regagner le giron atlantiste et suffisante pour lui faire oublier ses velléités de jeu personnel dans l’arène régionale, de la Méditerranée orientale à la Caspienne via la Mer noire. Tant et si bien que, le 30 juin, l’Union européenne relançait les négociations d’adhésion de la Turquie en ouvrant à Bruxelles un nouveau chapitre relatif à la sécurité alimentaire, vétérinaire et phytosanitaire (le treizième depuis l’ouverture des négociations d’adhésion en 2004 sur les 35 prévus afin d’adapter la législation des candidats aux normes européennes)…
À l’évidence l’UE, dans le cadre du smart power [6] préconisé à Washington (une étroite association de produits d’appels et de contraintes) avait été mandatée afin de « récupérer » Ankara. Le secrétaire états-unien à la Défense, M. Robert Gates n’avait-il pas en effet dénoncé un peu auparavant « ceux qui en Europe poussent la Turquie vers l’Est en refusant de lui donner le lien organique avec l’Occident qu’elle recherche". Autrement dit son entrée dans une Union pourtant déjà incapable de se gérer à vingt-sept ! Autre coïncidence ou hasard calendaire, toujours le 30 juin 2010, la discrète rencontre ministérielle à Bruxelles entre représentants turcs et israéliens au moment même où Ankara demandait à Washington moins de laxisme à l’égard de la rébellion armée du PKK [7].
Parallèlement, le 24 juin, à la suite des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité, le Congrès états-unien avait validé le durcissement la politique US à l’encontre de l’Iran en votant un nouveau train de mesures coercitives, mesures adoptées à l’unanimité par le Sénat (99 pour, 0 contre)… Le chef de la majorité démocrate de la chambre haute Harry Reid résumant l’état d’esprit des parlementaires : "Notre objectif est de viser l’Iran là où cela fait le plus mal" !
En l’occurrence il s’agit de créer une pénurie énergétique (mortelle à terme) en interdisant toute entrée de produits pétroliers raffinés ou tout équipement destiné à rendre à l’Iran une quelconque capacité de raffinage. Quatrième producteur mondial de pétrole brut, l’Iran manque cependant de raffineries, certaines ayant d’ailleurs fait l’objet d’attentats ces dernières années [8] et de fait, dépend fortement de ses importations pour la satisfaction de ses besoins intérieurs, importés à quelque 40%. Remarquons ici que la Résolution du Conseil de Sécurité (votée à l’unanimité des cinq membres permanents, Turquie et Brésil ayant voté contre et le Liban s’étant abstenu) n’a eu pour objet que de servir de cache-sexe, autrement dit de cautionner les mesures autrement plus sévères prises par les États-Unis et prochainement par l’UE.
Le républicain John McCain, concurrent de Barak Obama à la présidence, avait pour sa part clairement explicité la portée d’un texte dont le but est de « forcer les entreprises partout dans le monde à faire un choix : voulez-vous travailler avec l’Iran, ou bien voulez-vous travailler avec les Etats-Unis ? Les deux ne sont pas compatibles », énonçant de cette façon que les rigueurs du Nouvel Ordre Mondial ne s’adressent pas seulement aux récalcitrants arcboutés sur l’État-nation, fût-il islamique, mais à tous ceux qui se refusent à passer sous les fourches caudines du Marché unique universel dont le chef d’orchestre est, évidemment, anglo-américain. C’était déjà la teneur du message envoyé au monde par le président Bush au lendemain du 11 Septembre « ceux qui ne sont pas avec nous, seront contre nous »…
Un message reçu cinq sur cinq à Bruxelles et anticipé par quelques géants européens tels l’allemand Siemens ou le français Total [9], contraints et forcés l’un et l’autre en vertu de choix politiques. Une fois n’est pas coutume, le politique ayant pris le pas dans ce cas sur des intérêts économiques quasiment vitaux en période de récession.
En janvier 2010, Siemens officialisait la rupture – imposée par Mme Merkel – de ses liens commerciaux avec la République islamique d’Iran tout en honorant les commandes en cours… une décision en réalité déjà effective depuis octobre 2009. Fin janvier, la chancelière allemande pouvait annoncer que l’Allemagne s’associerait pleinement à de nouvelles sanctions « dans tous les secteurs concernés ». Sachant que les sociétés allemandes avaient exporté vers l’Iran pour environ 3,3 milliards d’euros dans les premiers 11 mois de l’année 2009 (la part
Siemens se montant alors à quelque 500 millions d’euros annuels) on voit ici qu’elle est l’ampleur du sacrifice consenti par l’industrie allemande pour se mettre en conformité avec les engagements transatlantiques européens. Résultat, la position strictement atlantiste de Mme Merkel au détriment des intérêts immédiats de l’économie allemande, a beaucoup contribué à l’affaiblissement de son crédit politique aujourd’hui déclinant.
Quant au pétrolier français Total, agissant également à rebours des intérêts nationaux et sur injonction directe de la présidence, a officialisé le 28 juin la cessation de ses livraisons d’hydrocarbures à l’Iran rejoignant de cette manière ses consœurs British Petroleum et Royal Dutch Shell dans la cohorte des compagnies pétrolières boycottant l’Iran. Une déclaration de pure forme car la suspension effective, sine die avait commencé depuis plusieurs semaines avant même le vote de la Résolution 1929et des oukases du Congrès… lesquels faisaient aboutir le projet de loi d’avril 2009 instituant des sanctions contre les compagnies fournisseuses de carburants à l’Iran, au premier chef, Total et British Petroleum. À ce titre, nul n’a été surpris de voir la décision de renoncer au marché iranien du groupe français annoncée d’abord sur le site du Financial Times et ce, avant toute déclaration en France même.
Last but not least, depuis juin dernier, l’UE avait commencé d’interdire son espace aérien à la majorité des appareils Airbus et Boeing de la compagnie Iran Air. Un mois plus tard, Bruxelles ajoutait à sa liste d’interdiction les Airbus A-320, les Boeing B‑727 et B-747. Simultanément, le Royaume-Uni et l’Allemagne, à l’instar des Émirats arabes unis [10], eu égard aux sanctions tant états-uniennes qu’européennes, refusaient tout ravitaillements en kérosène aux avions civils iraniens en dépit d’une évidente violation des conventions internationales pertinentes.
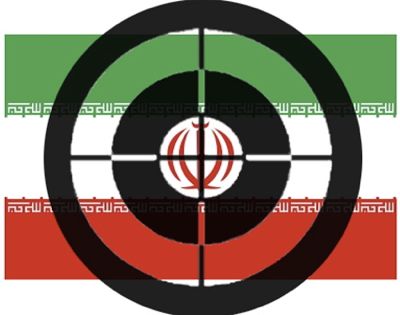
Guerre de communiqués et gesticulations militaires
Aux mesures de confinement économique et financier (la plus part des transactions financières de l’Iran ayant été rendues impossibles hors de ses frontières) viennent s’ajouter d’autres mesures, actives celles-là (mesures actives terme désignant à l’origine les opérations de désinformation ne visant pas seulement les élites dirigeantes mais visant plus largement au conditionnement et à la manipulation des opinions publiques). Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une guerre psychologique qui ne dit pas non nom mais qu’a dénoncée à bon escient le gouvernement iranien le 28 juin 2010 alors que le Directeur de la Central Intelligence Service, Leon Panetta, estimait péremptoirement sur la chaîne ABC que « Téhéran dispose maintenant de suffisamment d’uranium enrichi pour la confection de deux armes nucléaires dans un délais de deux ans ».
Verdict qui tombe après que l’Agence Guysen International News eut diffusé le 24 juin une information donnée pour être d’origine iranienne (!) suivant laquelle « … des avions israéliens auraient atterris sur l’aéroport saoudien de Tabouk les 18 et 19 juin dernier…C’est ce qu’a rapporté l’agence iranienne FARS dans un article intitulé “Activité militaire douteuse du régime sioniste en Arabie Saoudite“ ». Rumeur reprise ensuite par le Times de Londres qui n’hésite pas à annoncer que l’Arabie Saoudite aurait ouvert son espace aérien à l’aviation israélienne en prévision d’une attaque contre l’Iran, une information bien entendu non confirmée à Tel-Aviv et démentie par Riyad.
Difficile alors de faire la part entre rumeurs et faits avérés. Parmi les faits documentés relevant (ou non) de l’intoxication et de la guerre psychologique, signalons que pendant que l’État hébreu se livrait à des manœuvres d’envergure pour contrer une éventuelle attaque de son territoire par des missiles, les États-Unis complétaient leur dispositif offensif dans le Golfe et alentours [11].
Toujours dans le contexte d’une guerre par médias interposés, d’après le quotidien londonien Al-Qods Al-Arabi, information encore reprise par Guysen News, un convoi composé de 11 frégates états-uniennes et une israélienne, le tout accompagnant le porte-avions à propulsion nucléaire USS Harry S Truman, aurait transité par le Canal de Suez en direction la Mer Rouge. Enfin l’Iran aurait mis en état d’alerte ses forces proches de la Mer Caspienne en raison d’une « concentration de forces israélo-américaines en Azerbaïdjan » ! C’est en tout cas ce qu’a déclaré le 22 juin 2010 le général Mehdi Moini commandant des Gardiens de la Révolution : « la mobilisation se justifie par la présence de forces américaines et israéliennes sur la frontière de l’Ouest… ces renforts sont dépêchés dans la province d’Azerbaïdjan occidental car certains pays occidentaux attisent des conflits ethniques afin de déstabiliser cette région ». L’exécution le 20 juin 2010 d’Abdolmalek Rigi, chef du Jondallah, responsables de plusieurs attentats meurtriers contre les Gardien de la Révolution au Baloutchistan iranien est à ce titre un signal fort envoyé par les autorités iraniennes à l’attention de toutes les autres minorités susceptibles de fomenter des troubles dans une conjoncture s’inscrivant dans une inexorable stratégie de la tension.
C’est dans ce contexte que l’État hébreu aurait en effet, toujours selon la rumeur, prépositionné une flotte aérienne d’attaque en Azerbaïdjan. Là encore l’extrême prudence étant de rigueur, il faut noter l’inflation de rumeurs qui crée un climat propice à toute provocation ou tout accident accélérateur ou déclencheur d’une confrontation directe. En tout état de cause, l’utilisation de l’Azerbaïdjan comme base de lancement de raids aériens parait assez improbable si l’on considère l’actuel refroidissement des relations entre Bakou et Washington depuis avril, l’Azerbaïdjan ayant pris ombrage du rôle joué par le département d’État dans le conflit du Haut-Karabakh qui l’oppose à l’Arménie et annulé en conséquence des manœuvres militaires conjointes avec la marine des États-Unis…
Faisant d’ailleurs écho, le même jour, aux déclarations du commandant des Pasdaran, le 22 juin donc, le Dr Uzi Arad, chef du Conseil de Sécurité nationale israélien et proche conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahou, avait jeté sa part d’huile sur le feu en jugeant « le dernier volet des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, est insuffisant pour contrarier les progrès iraniens en matière de fabrication de l’arme nucléaire. Une intervention militaire préventive pourrait être finalement nécessaire ». Aujourd’hui c’est au tour de la CIA par la voix de son directeur d’enfoncer le clou…
Alors gesticulations guerrières, guerre des mots et intoxication, ou préparation psychologique à ce que le camp belliciste s’acharne à présenter comme inéluctable : le recours à la force contre Téhéran ? Toujours est-il que la guerre des nerfs fait rage dans cette partie de poker menteur à échelle planétaire à laquelle, bon gré malgré, nous sommes conviés à participer !
*****
Nous ne conclurons pas ici sur les conséquences à terme du défi que la Turquie au premier chef, le Brésil ensuite, ont lancé aux États-Unis et à ses commensaux britannique et hébreu. De toute évidence la Turquie n’avait pas envisagé que les choses iraient si loin, ni la vigueur de la réaction anglo-israélo-américaine… Chacun a priori s’attache aujourd’hui, de part et d’autre, à calmer le jeu et à replacer le contentieux dans le cadre formel des échanges diplomatiques [12]. On a, de ce point de vue, cru voir s’amorcer ce retour à la normale avec l’entretien de Bruxelles entre ministres turc et israélien, la Turquie en demandant des excuses israéliennes, l’indemnisation des victimes après l’affaire du Mavi Marmara, le tout assorti d’une levée du blocus de Gaza. Il était loisible de penser que dans le contexte d’un désaccord affiché entre Washington et Tel-Aviv, la Turquie aurait dû obtenir, au moins partiellement, gain de cause : Tel-Aviv n’est-il pas déjà en train d’alléger le dispositif d’asphyxie de la bande de Gaza dont le but avoué était de pousser la population à se soulever contre le gouvernement élu du Hamas ?
Un embargo qui s’est avéré être non seulement erroné mais, qui plus est, est devenu totalement contreproductif… Et bien contre toute attente Ankara s’est vu opposer un refus cassant et intransigeant à sa demande d’excuse, qui aurait pu être simplement « formelle ». Immédiatement après, ce nouveau camouflet : la Maison-Blanche, accueillant à bras ouverts le Premier ministre israélien, M. Benyamin Netanyahou, a offert au monde le spectacle d’une réconciliation d’assez mauvaise augure en ce qu’elle cautionne contre vents et marées la politique de la coalition dominée par le Likoud ultrasioniste au pouvoir à Tel-Aviv.
Des démonstrations d’amitiés qui suivent de peu le limogeage du général McChrystal, chef des forces états-uniennes et de l’Otan en Afghanistan, pour des propos malvenus d’après boire et son remplacement par le général David Petraeus [13] déjà chargé du commandement central [United States Central Command] du front allant de la Mésopotamie au Waziristan (Zones tribales du Pakistan).
La démarche turco-brésilienne a par conséquent certainement procédé d’une mauvaise évaluation du rapport de forces réel existant toujours entre les États-Unis – maîtres du jeu planétaire jusqu’à plus ample informé – et le reste du monde, malgré le fait incontestable que ce jeu se complexifie et se diversifie davantage avec l’arrivée, sur la scène internationale, de puissances montantes qui à leur tour revendiquent une place à la table des « Grands ».
La punition militaro-diplomatique n’ayant pas tardé sous forme d’un « acte de guerre » perpétré en haute mer (et en toute impunité), les mesures de rétorsions économiques et commerciales ne devraient pas se faire attendre très longtemps. Prenons l’exemple de la France qui, après 2003 et sa sortie au Conseil de Sécurité (intolérable du point de vue des partisans de l’annihilation de l’Irak), a souffert de la vindicte états-unienne au point d’amorcer dès 2004 son retour dans le giron Atlantique [14].
En résumé, l’initiative tripartite, opération éminemment louable du point de vu de la paix entre les nations, se sera révélée au final assez désastreuse parce ce que non seulement elle n’a pas permis de squeezer les États-Unis, mais qu’elle leur a offert la possibilité de déplacer leurs pions plus vite que prévu sur le grand échiquier eurasiatique. Pire, l’initiative tripartite a fourni le prétexte et l’occasion aux États-Unis de faire preuve de cette capacité de « rebond », cette « ressource » qu’exalte au plus haut degré la culture du Nouveau Monde. De plus, elle a, d’une certaine façon, précipité les « événements » en créant l’urgence et en entamant la marge de manœuvre des Anglo-Américains jusqu’à les pousser, peu ou prou, au passage à l’acte dans un processus de diplomatie armée qui va crescendo.
Alors quelles leçons tirer de cet accord turco-irano-brésilien qui a suscité le fugace espoir de voir s’engager une amorce de stabilisation régionale ? En premier lieu que le rapport du fort au faible n’offre que peu d’échappatoires. La Fontaine nous l’a autrefois enseigné : la rhétorique du « loup » ne tient aucun compte ni de la raison, ni du Droit, a fortiori du droit international, ni de la justice… Que le discours du « fort » subvertit en soi les valeurs en principe fondatrices des relations entre les individus d’abord, entre les sociétés ensuite.
Nous avons là une sophistique consensuelle donnant une apparence de rationalité légaliste à l’expression de l’imperium hégémonique, verbalisme de chancellerie qui n’est au demeurant qu’une transposition du dialogue au bord du ruisseau des deux animaux de la fable. L’Iran est pareillement un coupable sui generis et doit par conséquent se soumettre inconditionnellement. S’il ne s’y résigne pas de son propre gré, il sera ramené de gré ou de force dans le droit chemin démocratique et libéral. Ce cas de figure n’est pas nouveau et les historiens, s’ils cherchent un peu, trouveront de multiples précédents au cours du XXe siècle.
Nous voyons donc ici, à la croisée des chemins, à quel point, au XXIe siècle, la ruse, enveloppée du brouillard verbal propre au smart power prime sur l’immédiat exercice de la force brutale, mais qu’elle l’annonce cependant tout comme la nuée porte l’orage. À ce titre les « prophéties » du Líder Máximo cubain, quelqu’atteint par l’âge qu’il soit, renvoie étonnamment aux avertissements prodigués par la présidence russe.
La guerre, si elle devait avoir lieu, n’aurait à ce titre pas grand chose à voir avec une quelconque fatalité plus ou moins inhérente à de supposées lois physiques de la nature géopolitique du monde. Elle interviendrait pour la simple et unique raison que des factions influentes d’ultras, à Washington, à Londres et à Tel-Aviv, la veulent assidûment et la préparent avec ardeur et que ces mêmes factions auront fini par l’emporter sur les clans et les hommes hostiles à l’affrontement entre forces matérielles.
Bien des naïfs, croyaient en décembre 1990 que la guerre du Koweït serait évitée parce que des négociations allaient bon train entre Bagdad et Riyad ; parce qu’également le raïs Saddam Hussein avait offert de se retirer si un certain délais lui était accordé lui permettant de « sauver la face ». La guerre a eu lieu. Elle a eu lieu pour l’unique raison que l’« on » voulait qu’elle eût lieu. Or la situation d’aujourd’hui offre de nombreuses similitudes avec celle de décembre 1990. Il ne manque plus au tableau qu’un prétexte plausible, une provocation intervenant n’importe où dans le monde mais suffisamment spectacularisable pour frapper les opinions de sidération, cela, le temps nécessaire à lancer les premières frappes qui tétaniseront les oppositions en les prenant de court et enclencheront automatiquement l’escalade militaire.
Conflit qui serait sans doute appelé à déborder rapidement hors du cadre régional comme l’en a averti le président russe, Dimitri Medvedev. Un conflit qui alors pourrait constituer une opportune porte de sortie à la crise systémique globale qui, aujourd’hui, commence à menacer le statut d’idole du divin dollar [15] : la guerre n’est-elle pas « le » moyen de régulation par excellence ?

Plus grave, nous devons nous garder, aujourd’hui plus que jamais, d’une appréciation fausse du rapport de force global qui est toujours en faveur des États-Unis comme nous en administre la preuve le ralliement volens nolens de la Russie et de la Chine au durcissement des sanctions. Une attitude analogue à celles de ces navires qui fuient sous le vent pour tenter d’échapper à la tempête… pour l’immédiat, les deux challengers eurasiatiques des États-Unis se trouvent littéralement aspirés par la volonté américaine de liquidation du régime iranien et d’inclusion dans sa sphère d’influence de tout l’espace géoécopolitique des Balkans à l’Hindou Koush.
Les États-Unis - John Pitbull - n’en démordront pas, chacun doit se persuader que la chute du régime iranien n’est plus du domaine du négociable. Russes et Chinois le savent et leur comportement démontre qu’ils ne disposent pas de la monnaie d’échange susceptible d’infléchir le projet états-unien. Une ambition dont le succès à terme n’est d’ailleurs pas assuré comme les échecs des révolutions colorées géorgienne et ukrainienne en témoignent.
De sorte que Moscou et Pékin peuvent tout au plus jouer le rôle de ralentisseurs d’un processus qu’ils savent, sauf accident de parcours, inéluctable. Finalement l’épisode de l’initiative tripartite aura eu le vrai mérite de mettre les choses au point et de nous donner un cliché exact de l’état des lieux géostratégiques, c’est-à-dire en montrant le caractère (provisoirement) illusoire d’un rééquilibrage des pouvoirs dans un monde encore assez éloigné de la multipolarité.
Ce constat contredit finalement – en dépit des différents conflits qui déchirent le Proche-Orient ces deux dernières décennies – l’idée que nous assisterions tendanciellement à un déclin de l’expansionnisme états-unien en dépit de deux fronts et de deux enlisements, l’irakien et l’afghan… tout aussi bien que par les conséquences économiques et sociales d’une crise financière que Washington est pourtant encore loin d’avoir complètement surmonté.
À cet égard, écartons définitivement l’idée – laquelle ressort de la méthode Coué, c’est-à-dire de l’autosuggestion – qu’en raison de ses difficultés budgétaires, l’État fédéral états-unien n’aurait plus la capacité d’aller au bout de ses intentions belliqueuses. Une idée controuvée à l’heure de la guerre des drones de combat et des missiles de croisières hypersoniques à portée intercontinentale.
Au contraire ce sont ces difficultés mêmes et les menaces que font peser sur la suprématie du dollar les actuelles défaillances structurelles du système hypercapitaliste ultralibéral qui pourraient le cas échéant contraindre l’État fédéral à une fuite en avant, comme ce fut le cas dans les années ayant précédé la Seconde Guerre mondiale. Mais à la différence du temps du président Roosevelt, dont les intentions véritables étaient masquées par un discours et des dispositions à caractères pacifistes (embargo sur les armes à destination de l’Europe), les discours du président Obama se situent aujourd’hui en contradiction avec les faits les plus patents et, de facto, ne parviennent plus guère à donner le change.
Enfin, last but not least, à l’appréciation erronée du poids relatif sur la scène internationale des « émergents » et de leur potentiel en matière de bargaining power (car il est nous est interdit de prendre nos désirs géopolitiques pour des réalités géostratégiques !) vient se surajouter une confiance excessive des dirigeants iraniens dans leur capacité à dissuader les israélo-anglo-américains de procéder à des frappes préventives… Ceux-ci seraient arrêtés dans leur élan guerrier par la crainte supposée d’un prix à payer trop élevé : les dirigeants iraniens croient en effet que l’importance des pertes qui seraient induites chez l’agresseur lui rendent le coût du passage à l’acte tout à fait rédhibitoire…
Quant aux mesures que prendrait l’Iran en cas de frappes préventives, elles sont déjà parties prenantes du script des opérations. Qu’une salve de missiles de croisière, avec ou sans tête nucléaire, tirée depuis les sous-marins vendus à l’État hébreu par l’Allemagne social-démocrate, touchent des centres vitaux iraniens, que la réplique en représailles de Téhéran sur des bases ou des navires états-uniens détermine des pertes significatives dans le corps expéditionnaire coalisé (du même ordre que lors de l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, laquelle fit 2403 victimes, seuil psychologique comparable à celui atteint avec les destructions des Tours jumelles, préalable à l’assaut lancé contre le bastion afghan), la presse occidentale se déchaînera muselant une opinion publique tétanisée comme elle l’a été le 11 septembre 2001, nous entrerons alors dans l’engrenage infernal de la guerre sans limites engagée par le président George Walker Bush contre les « ennemis » de l’Amérique.
Nous n’aborderons pas ici, l’hypothèse vraisemblable, de l’ouverture préalable d’un premier front au Liban, voire en Syrie alliée de l’Iran, afin de réduire la pression exercée par les tirs de missiles du Hezbollah sur le nord d’Israël… Sans oublier le scénario de basse intensité comportant la fermeture du détroit d’Ormuz… mais à y regarder de plus près, celle-ci ne ferait que retarder l’échéance d’une campagne (déjà planifiée) de frappes massives destinées à donner toutes ses chances aux forces intérieures œuvrant au renversement du régime. Le scénario « Ormuz » devant se révéler tout aussi impuissant à dissuader les attaquants potentiels… L’artère jugulaire d’Ormuz par laquelle transitent près de 30 % de la production mondiale des hydrocarbures nécessaires à faire tourner le moteur planétaire, fermée, un baril qui bondirait à 300 $ serait d’ailleurs une aubaine inespérée pour les Majors, le cartel des grandes Compagnies pétrolières, qui pourraient dès lors se lancer dans l’exploitation à haut coût des schistes et des sables bitumineux du Groenland et d’ailleurs ou se lancer dans d’aventureuses campagnes de forages en eaux profondes comme dans le golfe du Mexique et avec le « succès » que l’on sait.
Sauf par conséquent à ce que l’initiative tripartite ne soit reprise par une large coalition conduite par la Russie et la Chine, ce qui semble peu probable dans la conjoncture présente, le scénario du pire, sous les deux versions qui viennent d’être évoqués – frappes préventives, représailles, fermeture d’Ormuz – est en fait de plus en plus plausible. Et sauf une levée de bouclier internationale particulièrement nette et ferme, La guerre de Troie aura bien lieu si les dieux assoiffés de puissance qui siègent dans l’île de Manhattan et règnent sur la Cité de Londres s’accordent entre eux et en décident ainsi. Il restera aux stratèges de décider s’ils frappent directement la Perse, ou s’ils font éclater un conflit à sa marge, pour l’y précipiter et l’y détruire.
[1] « Joint Declaration by Iran, Turkey and Brazil on Nuclear Fuel », Voltaire Network, 17 mai 2010. « Contentieux nucléaire Iranien et divergences Américano-Turques, par Jean-Michel Vernochet, Geopolintel, 12 juillet 2010.
[2] A propos d’une attaque procédant d’une stratégie intercontinentale de guerre éclair du XXIe siècle, Rick Rozoff développait l’idée que les É-U entendrait, en raison d’une supériorité proprement écrasante, « remporter la victoire sans même avoir engager la bataille » dans la mesure où « l’adversaire connaît sa vulnérabilité à une offensive instantanée, non détectable, écrasante et dévastatrice, sans capacité de défense ou de représailles ». Doctrine qui n’est que la stricte application des enseignements datant du VIe siècle av.J.C, toujours à l’honneur dans les Écoles de guerre américaines, du général chinois Sun Tzu. La dissymétrie massive des forces entre les protagonistes se résume d’ailleurs en un seul chiffre : 708 milliards de dollars pour le budget de la défense états-unien à comparer aux 7,31 milliards de dollars pour l’Iran (estimation pour 2007 de l’Institut d’études stratégiques de Londres). « Prompt Global Strike : World Military Superiority Without Nuclear Weapons », par Rick Rozoff, Voltaire Network, 21 avril 2010.
[3] Le terme « national-islamiste » fait référence au « national-catholicisme » de la Pologne de Lech Walesa, épine dans le pied de l’Union soviétique expirante. Ce qui est en cause dans le contentieux irano-américain, ce n’est pas tant la dimension religieuse islamique d’un État « théocratique », que sa dimension souverainiste. Le nouvel ordre régional voulu par Washington sur le Rimland eurasiatique, des Balkans à l’Hindou Koush, est incompatible avec des gouvernements autonomes non intégrés au système global dominé par Washington, Chicago, New York et Londres. Il s’agit donc de faire sauter tout les verrous de souveraineté : ceci a été vrai pour la Fédération de Yougoslavie détruite à l’issue de la guerre de 1999 et de l’Irak en 2003. Le Shah d’Iran, Reza Pahlavi, est lui-même tombé, abandonné de l’Administration Carter, pour avoir eu la velléité de renouer avec le nationalisme pétrolier de Mossadegh. L’Iran est en vérité plus « kémaliste » que d’aucuns ne l’imaginent, l’État profond iranien se situant non pas dans un clergé au demeurant assez favorable aux concessions, que chez les Gardiens de la Révolution (les Pasdaran) lesquels constituent le noyau dur assurant la stabilité de l’édifice politique iranien au même titre que l’armée turque forme, encore aujourd’hui, un État dans l’État.
[4] « Résolution 1929 du Conseil de sécurité », Réseau Voltaire, 9 juin 2010.
[5] Nouvelle doctrine de la diplomatie américaine le smart power est une combinaison ou un moyen terme entre le hard power (pouvoir de coercition manu militari) et le soft power (pouvoir d’influence, de conviction et de persuasion). La secrétaire d’État américaine, Mme Hillary Clinton, lors de son audition devant la commission sénatoriale chargée d’avaliser sa nomination a présenté le nouveau concept en ces termes : « Nous devons avoir recours à ce qui a été appelé “le pouvoir de l’intelligence“ [lequel rassemble] l’ensemble des outils mis à notre disposition : diplomatiques, économiques, militaires, politiques, légaux, et culturels – il faut choisir le bon outil, ou la bonne combinaison d’outils, la mieux adaptée à chaque situation".
[6] Gardons en mémoire que l’autre entente tripartite, anglo-américano-israélienne, en effet n’a pas tardé à faire payer à la Turquie son audace, d’abord en donnant l’assaut, dans la nuit du 30 au 31 mai 2010, de la flottille humanitaire turque, action qui devait faire 9 victimes parmi les passagers du Mavi Marmara. Puis, peu après, le 18 juin, le PKK (Parti kurde de travailleurs) lançait une attaque contre un poste frontière turc au nord de l’Irak occasionnant 8 morts parmi les gardes frontières turcs. Les observateurs les plus avertis ont vu dans ces événements, non pas des dérapages incontrôlés ou de simples accidents, mais un « signal fort », envoyé de façon préméditée par le « 51ème état de l’Union » à l’attention des dirigeants turcs de l’AKP, le parti islamique néo-ottoman au pouvoir à Ankara. Deux événements par conséquent non fortuits, sachant que, pour le second, le PKK est réputé bénéficier du soutien actif de conseillers israéliens et d’une certaine « tolérance » en Irak de la part des forces américaines.
[7] En lutte ouverte contre le pouvoir central turc depuis 1984, le bilan du conflit avec le PKK s’établirait à 45 000 morts de tous bords dont 50 au cours du seul mois de juin 2010. Par conséquent un sujet de préoccupation permanent pour Ankara, à telle enseigne que, le 30 juin, le vice-Premier ministre turc Cemil Ciçek a, une nouvelle fois, remis sur le tapis la question du « laxisme » états-unien à l’égard des rebelles du PKK… Parallèlement, le même jour, avait lieu à Bruxelles une rencontre discrète, à l’initiative d’Ankara (?) entre le ministre israélien du Commerce, Benjamin Ben Eliezer, et Ahmet Davutoglu Ministre turc des Affaires étrangères, en vue de désamorcer l’actuelle crise bilatérale. Ce premier contact ministériel israélo-turc depuis le 31 mai date de l’arraisonnement de la flottille internationale, a été établi sous couvert du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou en court-circuitant le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman.
[8] « Iran : minorités nationales, forces centrifuges et fractures endogènes », par Jean-Michel Vernochet, in Maghreb-Machrek, octobre 2009.
[9] L’Allemagne est traditionnellement l’un des grands partenaires de l’Iran, Siemens en particulier présent en Perse depuis 1868 lorsque l’entreprise allemande s’employait à poser la première ligne télégraphique reliant Londres aux Indes. En 2008, les entreprises allemandes avaient livré des produits pour une valeur de 3,9 milliards d’euros à l’Iran et seulement 3,3 en 2009.
[10] Selon le Washington Times - 7 juillet 2010 - l’ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, Youssef Al Otaïba (en vérité peu « représentatif » en raison des analyses divergentes de crise iranienne prévalant au sein des Émirats), a publiquement prôné le recours à la force dans le règlement du contentieux nucléaire iranien en cas d’échec des sanctions contre Téhéran. De la même manière que les gouvernements français et allemand, les ÉAU font passer leurs allégeances politiques avant leurs intérêts économiques, le commerce entre les Émirats et l’Iran se montant par an à la bagatelle de 12 milliards de dollars.
[11] « Israël se prépare à la guerre » selon la plupart des médias arabes lors du lancement le 23 mai 2010 de manœuvres baptisées « Tournant 4″ », vaste exercice (4e du genre depuis la guerre au Liban en 2006), destiné à contrer une éventuelles attaque de missiles de la part du Hezbollah ou de l’Iran.
Le dispositif naval états-unien aux abords du Golfe arabo-persique se composait encore récemment d’une flotte de combat tout à fait imposante : Carrier Strike Group 10, headed by the USS Harry S. Truman aircraft carrier, sails out of the US Navy base at Norfolk, Virginia Friday, May 21. On arrival, it will raise the number of US carriers off Iranian shores to two. Up until now, President Barack Obama kept just one aircraft carrier stationed off the coast of Iran, the USS Dwight D. Eisenhower in the Arabian Sea, in pursuit of his policy of diplomatic engagement with Tehran. For the first time, too, the US force opposite Iran will be joined by a German warship, the frigate FGS Hessen, operating under American command. It is also the first time that Obama, since taking office 14 months ago, is sending military reinforcements to the Persian Gulf. Our military sources have learned that the USS Truman is just the first element of the new buildup of US resources around Iran. It will take place over the next three months, reaching peak level in late July and early August. By then, the Pentagon plans to have at least 4 or 5 US aircraft carriers visible from Iranian shores.The USS Truman’s accompanying Strike Group includes Carrier Air Wing Three (Battle Axe) - which has 7 squadrons - 4 of F/A-18 Super Hornet and F/A-18 Hornet bomber jets, as well as spy planes and early warning E-2 Hawkeyes that can operate in all weather conditions ; the Electronic Attack Squadron 130 for disrupting enemy radar systems ; and Squadron 7 of helicopters for anti-submarine combat (In its big naval exercise last week, Iran exhibited the Velayat 89 long-range missile for striking US aircraft carriers and Israel warships from Iranian submarines.) Another four US warships will be making their way to the region to join the USS Truman and its Strike Group. They are the guided-missile cruiser USS Normandy and guided missile destroyers USS Winston S. Churchill, USS Oscar Austin and USS Ross.
[12] À telle enseigne que la Turquie, bien que déboutée par le refus cinglant de Tel-Aviv de lui présenter des excuses pour l’épisode sanglant du Mavi Marmara le 31 mai dernier, vient, le 13 juillet 2010, par l’intermédiaire de son ministre chargé des relations avec l’Union Européenne, M. Egemen Bagis, de demander à Mme Catherine Ashton, Ministres des affaires extérieures de l’UE en visite à Istanbul, d’intervenir auprès de l’État hébreu afin de sortir de l’impasse diplomatique actuelle.
[13] New York Times du 25 mai 2010 : l’existence d’une directive « secrète » de septembre 2009 signée par le général David Petraeus, chef du Commandement central américain, autorisant l’intensification des opérations militaires secrètes au Proche-Orient, en Asie centrale (mais aussi dans la Corne de l’Afrique). Le document de 17 pages intitulé « Joint Unconventional Warfare Task Force Execute Order » autorise les unités spéciales à « pénétrer, perturber, vaincre ou détruire » toutes cibles en tous pays (y compris un pays allié comme l’Arabie saoudite) et ce, afin de « préparer l’environnement » à des offensives conventionnelles. En ce qui concerne plus particulièrement l’Iran la directive autorise explicitement « des missions de reconnaissance pouvant ouvrir la voie à de possibles f
Aucun commentaire
