Le triomphe de Wal-Mart : de l’esclavagisme comme modèle de développement
"Wall-Mart l’Entreprise monde", Nelson Lichtenstein & Susan Strasser, Ed. Les Prairies Ordinaires
mardi 5 mai 2009, par Lémi

En 1992, le président des États-Unis eut cette formule : « Le succès de Wal-Mart est le succès de l’Amérique. » Désormais, la multinationale de la distribution est devenue la plus grosse entreprise du monde. Et le dumping social qu’elle pratique – elle vient d’être condamnée à 172 millions de dollars d’amende pour avoir refusé à ses employés une pause-déjeuner – contamine l’économie occidentale.
En 2003, Wal-Mart ressemble beaucoup à l’Amérique de 2003 : une superpuissance sans rivale avec un accent du Sud.
Il y a un épisode de South Park qui représente bien ce que peut signifier Wal-Mart, aux yeux de l’Américain moyen. Rien d’étonnant : la plus grosse entreprise du monde, peu présente (proportionnellement) à l’international mais élément clé du paysage politico/social aux États-Unis, ne pouvait manquer de faire son apparition dans la série crétino-rentre-dedans de Trey Parker et Matt Stone. Dans cet épisode, donc, l’arrivée d’un Wal-Mart dans la petite ville du Colorado théâtre du dessin-animé finit par alarmer les enfants : leur épicier préféré a fait faillite, le centre-ville s’est vidé de ses commerces, leurs grands-parents travaillent de nuit pour des salaires de misère dans le nouveau magasin et leurs parents sont devenus des zombies cédant compulsivement aux sirènes de prix toujours plus bas. Finalement, une foule en colère brûle le magasin honni qui a vampirisé la ville. Le lendemain, stupeur, des pelleteuses s’affairent à mettre la dernière touche à un nouveau magasin flambant neuf, aussi moche que l’ancien, aussi destructeur socialement. La morale ? On ne détruit pas Wal-Mart car il fait partie de vous. Il est votre miroir, vous qui aimez tant les prix bas que vous ne cherchez pas à savoir ce qu’il y a derrière…

Il est difficile d’imaginer la puissance de ce géant de la distribution qu’est Wal-Mart. Les chiffres sont si démesurés qu’ils ne signifient plus rien : Wal-Mart représente 2,5% du PNB américain. Wal Mart possède un réseau privé de communication par satellites. Quatre des fils de la famille fondatrice figurent parmi les dix hommes les plus riches du monde. La chaine de distribution fait chaque année traverser le Pacifique à plus de 230 000 containers... On pourrait continuer longtemps ainsi, ça ne changerait pas grand-chose. Wal-Mart est tout simplement la plus grande entreprise du monde. Et son mode de fonctionnement n’en est que plus révélateur des faillites de notre économie globale.
Comme Ford, General Motors ou Microsoft avant elle, Wal-Mart est le reflet d’une époque, son symbole. Son gigantisme, sa démesure, son organisation, sa capacité de reproduction et d’adaptation, son management sans pitié ont transformé une entreprise plutôt banale de l’Arkansas en géant planétaire. Citée en exemple, copiée mais jamais égalée, elle est l’entreprise du 21e siècle, celle qui a mordu si fort dans son l’esprit des temps qu’elle se l’est accaparé. Ce n’est plus Wal-Mart qui symbolise l’époque, c’est l’époque qui symbolise Wal-Mart, ou presque.
Cela valait bien une étude poussée. Ça tombe bien : celle que vient de publier les Prairies Ordinaires, Wal-Mart, l’Entreprise Monde, est particulièrement réussie.
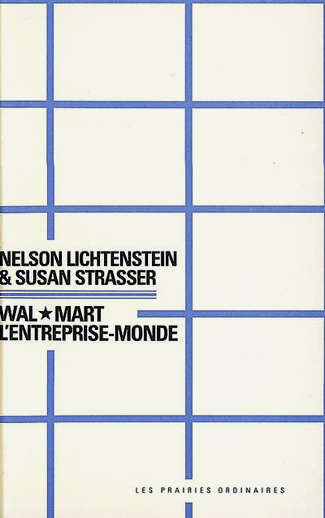
Le livre se compose en deux contributions distinctes mais joliment complémentaires, celles de deux auteurs américains, Nelson Lichtenstein et Susan Strasser [1]. Leurs textes abordent - chacun à leur manière - la puissance symbolique et effective de la chaîne de distribution.
La première partie montre comment le modèle incarné par Wal-Mart est celui de la compression salariale la plus décomplexée : la vitalité économique de la chaîne tient en grande partie à sa capacité à exploiter ses employés jusqu’à la lie.
La deuxième, celle de Susan Strasser, remonte l’histoire de la marchandisation de masse pour trouver les racines du mal Wal-Mart, alliance de marketing conservateur et de calculs économiques ultra-libéraux. Une alchimie socialophage déjà concoctée auparavant par d’autres enseignes, comme Woolworth .
Maison mère et dépendance : la "famille" Wal-Mart

Wal-Mart est comme les pirates patrouillant au large de la Somalie : chacun des esquifs offensifs est relié à un vaisseau mère, qui permet à ses rejetons de bénéficier d’une logistique efficace. Pour l’entreprise, il est situé à Bentonville, une bourgade de l’Arkansas, qu’on imagine charmante (ah, l’Arkansas…). C’est au cœur de ce siège historique, là même où un certain Sam Walton a fondé l’entreprise en 1962, que l’empire Wal-Mart est géré à la baguette. Jusqu’aux thermostats des différents magasins qui sont réglés depuis cette base opérationnelle.
Nelson Liechtenstein le rappelle, l’organisation de l’entreprise va à l’encontre du modèle Général Motors, autre entreprise qui s’était fait un temps reflet du monde. Alors lors que GM externalisait autant que possible, se débarrassant des fonctions productive - suivant en cela le schéma tracé par Naomi Klein dans « No Logo » : une marque n’est pas faite pour produire - , Wal-Mart a « trouvé le gigantisme très efficace et hautement profitable ».
Économiquement, la firme paraît anachronique. Elle le revendique, d’ailleurs : Wal-Mart se réclame d’une Amérique d’un autre temps, cultive des valeurs hautement conservatrices. Pourtant, son discours est profondément hypocrite : l’expansion de l’entreprise s’est d’abord basée sur les techniques les plus modernes. Ce que rappelle Dork zabunyan dans la préface de l’ouvrage :
Les plus hauts responsables de l’entreprise peuvent toujours feindre de mépriser la technologie - « Nous n’avons rien à voir avec elle, qu’elle soit "haute" ou "basse" , » osa déclarer Walton - , les chiffres ne trompent pas : Wal-Mart aurait investi un budget en informatique qui dépasserait celui de la NASA.
Que l’entreprise soit née dans l’Arkansas profond n’est pas anodin, Lichstenstein le souligne : « La compagnie est née et a commencé sa formidable croissance à une époque et dans un lieu particulièrement improbables. Ni le New Deal, ni la révolution des droits civiques n’étaient véritablement arrivés jusqu’au Nord-Ouest de l’Arkansas, cet État rural, presque entièrement blanc, sans syndicat et désespérément pauvre où Walton a commencé à constituer son empire provincial de la grande distribution. »
De cette base conservatrice, Wal-Mart n’a pas dévié d’un cil : encore aujourd’hui, elle met en avant la même idéologie. Et se fait le « promoteur d’une idéologie de la famille, de la foi et du sentimentalisme provincial qui coexiste de façon étonnamment harmonieuse avec l’âpreté du commercial, la stagnation du niveau de vie et la pression permanente exercée sur les employés. »
La haine du social : mort au New Deal, longue vie à Reagan !

Si l’entreprise se présente comme une famille, si elle appelle ses employés des « associés » et a rebaptisé ses départements des ressources humaines en « People Division », c’est bien pour maquiller d’un vernis humain une réalité assez peu reluisante : Wal-Mart traite ses employés comme des esclaves aisément remplaçables (le "turn-over" des employés y bat d’ailleurs des records) et leur dénie toute prérogative sociale. Ils peuvent s’estimer heureux d’avoir trouvé une famille prête à les accueillir. Pour le reste, ils n’ont aucun droit. Et quand un syndicat se crée dans l’entreprise, les rebelles, qui n’ont pas compris que Wal-Mart est une « famille » modèle et sans histoire, le payent par la fermeture de l’établissement. Ce fut le cas (entre autres) du site de Jonquière au Québec en 2005, immédiatement puni pour ses velléités sociales.
Serge Halimi cite ainsi la porte parole de l’entreprise, Mona Williams : « Notre philosophie est que seuls des associés malheureux voudraient adhérer à un syndicat. Or Wal-Mart fait tout ce qui est en son pouvoir pour leur offrir ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin. » En clair : les employés sont si heureux qu’ils ne devraient même pas songer à avoir des revendications. Que les salaires pratiqués par Wal Mart soient « inférieurs d’environ 31% à ceux des grandes enseignes du secteurs » ne compte évidemment pas. Peccadilles !
Rien d’étonnant, alors, si l’entreprise s’est particulièrement développée durant les Reaganomics, ces années ou l’Amérique pratiqua une politique libérale acharnée, où elle voyait les revendications sociales comme des freins à la croissance et où le New Deal de Roosevelt passait pour un gigantesque fourvoiement. Régulièrement, Wal Mart sponsorise les campagnes électorales des conservateurs, tandis que ses dirigeants copinaient gaiement avec Georges W. Bush pendant ses deux mandats.
Car, au final, c’est limpide : l’esclavagisme pratiqué par Wal-Mart n’est pas soluble dans un environnement réglementé. A tel point que l’élection d’Obama a constitué - sans aucun doute - une très mauvaise nouvelle pour les dirigeants de l’entreprise.
Quand Wal-Mart entraîne le monde

Wal-Mart, en tant que première boîte mondiale, constitue évidemment un modèle à suivre pour tous les managers du monde. En ce début de 21e siècle, une telle réussite fait saliver. Si les critiques se multiplient, si les premiers procès commencent à s’abattre sur une chaîne spécialisée dans le dumping social et l’esclavagisme (à l’intérieur des frontières comme à l’extérieur, Wal-Mart produisant nombre de ses produits en Chine), la fascination exercée par la firme est impressionnante.
C’est qu’en conjuguant prix bas et propagande, elle continue à renvoyer une image d’entreprise familiale modèle au service d’une Amérique provinciale, une sorte de sucess story à l’américaine (« Des haillons à la fortune », dixit Halimi). Petite entreprise née dans l’Arkansas en 1962 et devenue la plus grande chaîne du monde 40 ans plus tard, voilà qui fournirait un excellent scénario à Hollywood… Mieux : Wal-Mart ne se contente pas de faire rêver, elle inspire.
Susan Strasser le souligne, le modèle Wal-Mart est l’aboutissement d’un processus global, pas une anomalie. Lequel repose sur ce postulat que « la marchandisation de masse dépend du sacrifice des travailleurs sur l’autel des bas prix », ce que pratiquaient aussi des prédécesseurs tels Sears Roebuck, A&P ou Woolworth. Pour spécifique et gigantesque qu’elle soit, la firme s’inscrit parfaitement dans son époque, dans le développement de la société de consommation. A preuve : « Wal-Mart, la plus grande société commerciale du monde, est aujourd’hui l’entreprise-modèle de l’ordre économique global », écrit Lichstenstein.
Bref : une entreprise-modèle, Wal Mart ? Oui, celle du triomphe du néo-libéralisme outrancier, du fric-roi, de la société de consommation poussée à son extrême. Un rêve pour entrepreneurs décomplexés qui, parions-le, n’a pas fini de faire des émules. Et nous ne devons qu’à notre modèle européen honteusement rétrograde de ne pas profiter aussi des bienfaits de cette entreprise modèle (quand Wal-Mart a cherché à s’installer en Allemagne, les législations sociales en vigueur ont mis un terme à l’expérience). A priori, ça ne devrait pas tarder à changer. Car, Serge Halimi le rappelle, Wal-Mart n’en finit pas de gagner du terrain :
Wal-Mart n’est au fond que le symptôme d’un mal qui va. Chaque fois que le droit syndical est attaqué, que les protections des salariés sont rognées, qu’un accord de libre-échange accroît l’insécurité sociale, que les politiques publiques deviennent l’ombre portée des choix des multinationales, que l’individualisme du consommateur supplante la solidarité des producteurs, alors, chaque fois, Wal-Mart avance…
Craignant de me disperser, j’ai restreint le champ d’analyse. Du coup, certains aspects du livre sont juste évoqués, notamment les effets économico/structurels d’une politique de bas prix, le recours aux ouvriers chinois dans la production et l’histoire de la distribution de masse (la partie développée par Susan Strasser, pourtant passionnante). Raison de plus pour se reporter au livre.
A lire également sur le sujet, ce très bon article de Serge Halimi abondamment cité dans ce billet : Wal-Mart à l’assaut du monde.

Notes
[1] Nelson Lichtenstein et Susan Strasser ont participé à un ouvrage collectif publié aux États-Unis : Wal-Mart, The Face of Twenty-First Century Capitalism.. Les deux textes du livre publié aux Prairies Ordinaires sont tirés de cet ouvrage.