La tornade sécuritaire mondiale
Mouvements des idées et des luttes. 24 juin 2010 par Loïc Wacquant
Néolibéralisme et châtiment à l’aube du XXIe siècle
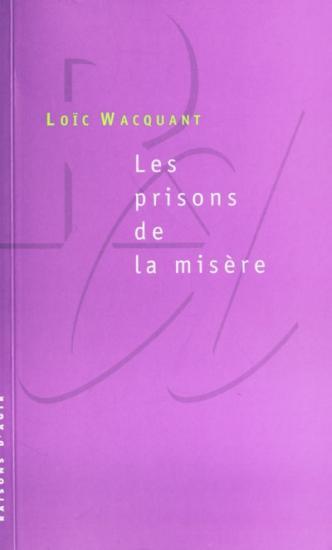 A l’occasion des 10 ans de la parution de son ouvrage Les Prisons de la misère, Loïc Wacquant revient dans un exercice d’auto-sociologie sur la réception intellectuelle et militante du livre. Il revient également sur les analyses livrées alors et revisite le modèle d’articulation entre néolibéralisme et État pénal à lumière des développements récents.
A l’occasion des 10 ans de la parution de son ouvrage Les Prisons de la misère, Loïc Wacquant revient dans un exercice d’auto-sociologie sur la réception intellectuelle et militante du livre. Il revient également sur les analyses livrées alors et revisite le modèle d’articulation entre néolibéralisme et État pénal à lumière des développements récents.A l’orée des années 1990, le nouveau maire républicain de New York, Rudolph Giuliani, a lancé une campagne policière de « tolérance zéro » visant à supprimer les désordres de rue en réprimant assidûment les petits délinquants, incarnés par le personnage interlope du squeegee man* [1] . Très vite, New York est devenue la vitrine planétaire d’une approche agressive du maintien de l’ordre qui, malgré son coût exorbitant et son absence de lien avéré avec la baisse de la criminalité, s’est vue admirée et imitée par d’autres grandes villes des États-Unis et de l’Europe de l’Ouest. Dans mon ouvrage Les Prisons de la misère, paru en 1999 chez Raisons d’agir Editions, je dissèque le processus d’incubation et d’internationalisation des slogans (« la prison, ça marche » [2]), des soi-disant théories (la « vitre brisée ») et des mesures (telles que le recours accru à l’incarcération, les « peines plancher », les camps de redressement et les couvre-feu pour jeunes) qui composent ce nouveau « sens commun » punitif, conçu pour endiguer la montée de l’inégalité et de la marginalité dans la ville postindustrielle. Je montre comment un réseau de think tanks conservateurs, éclos sous la présidence de Reagan et emmenés par le Manhattan Institute, les a forgés comme autant d’armes dans leur croisade pour le démantèlement de l’État-providence et la criminalisation de la pauvreté, sur fond d’accroissement des disparités économiques et de diffusion de l’insécurité sociale. Je retrace leur « import-export » par le truchement des politiciens convertis à la vision néolibérale, des médias dominants et des instituts de conseil en politique favorables au marché qui prolifèrent alors à travers l’Union Européenne, et notamment dans la Grande-Bretagne de Tony Blair. Et je montre comment, localement, des universitaires ont contribué à introduire en contrebande dans leurs pays respectifs les techniques étasuniennes de pénalisation en les revêtant d’un habillage savant. Ma thèse centrale établit un lien entre restructuration néolibérale et châtiment : le « consensus de Washington » sur la dérégulation économique et la réduction de la protection sociale a été élargi pour englober le contrôle punitif de la criminalité parce que la « main invisible » du marché nécessite et appelle le « poing de fer » de l’État pénal.
Dans le présent texte, je reviens sur la réception internationale des Prisons de la misère – l’ouvrage a été traduit dans vingt langues – comme révélateur des évolutions pénales dans les sociétés avancées au cours de la décennie passée. J’établis que la tornade sécuritaire mondiale inspirée par les États-Unis, que le livre détectait en 1999, a continué de faire rage de toutes parts. De fait, elle s’est étendue des pays du Premier monde à ceux du Second monde et elle a transformé les enjeux et les mesures politiques du châtiment pénal à travers la planète de façons que nul n’aurait pu prédire ou même croire possible il y a seulement quinze ans. J’élargis mon analyse du rôle des think tanks dans la diffusion de la pénalité « made in USA » à Amérique latine (ce que j’appelle l’« effet Giuliani »). Enfin, je revisite et révise le modèle initial du lien entre néolibéralisme et pénalité punitive, révision qui débouche sur l’analyse de la refonte de l’État à l’ère de l’insécurité sociale élaborée dans mon livre Punishing the Poor.
Sur les traces de la tornade sécuritaire autour du monde
Les Prisons de la misère emploie les outils des sciences sociales pour entrer et peser dans un débat public actuel de première importance au sein des pays occidentaux. Le thème du débat est le rôle accu de la prison et le virage punitif de la politique pénale perceptible dans la plupart des sociétés avancées lors des deux dernières décennies du XXe siècle et depuis. La cible d’origine était la France et ses voisins, en tant qu’importateurs avides des catégories, slogans, et mesures de lutte contre la criminalité élaborés dans les années 1990 aux États-Unis et vecteurs du basculement historique de ce pays de la gestion sociale vers la gestion pénale de la marginalité urbaine. L’objectif était de contourner le discours politique et médiatique dominant qui nourrissait la diffusion de cette nouvelle doxa punitive et d’alerter les chercheurs, les dirigeants associatifs et politiques, et les citoyens concernés en Europe, des ressorts douteux de cette diffusion, ainsi que des conséquences sociales et des dangers politiques de la croissance et de la glorification de l’aile pénale de l’État. Lorsque j’ai écrit ce livre, je ne comptais pas m’aventurer plus avant dans ce qui était pour moi un domaine d’investigation nouveau et peu familier. J’avais fait entrer l’appareil de justice pénale dans mon cadre analytique en raison de sa croissance prodigieuse et de son déploiement agressif au sein et au pourtour du ghetto noir américain en phase d’implosion après le reflux du mouvement des droits civiques, et j’avais la ferme intention de revenir aux questions d’inégalité urbaine et de domination ethnoraciale [3]. Mais, chemin faisant, deux développements inattendus m’ont incité à creuser ce sillon de recherche et d’activisme intellectuel.
Le premier est la réception inhabituelle du livre, d’abord en France puis dans les pays qui l’ont rapidement traduit, traversant les frontières qui séparent d’ordinaire la recherche, le militantisme et l’élaboration des politiques publiques. Le second est le fait que la double thèse qu’il avance – qu’un nouveau « sens commun punitif » forgé aux États-Unis dans le cadre de l’offensive contre l’État-providence est en train de traverser l’Atlantique et de se propager dans toute l’Europe occidentale, et que cette dissémination n’est pas une réponse interne à l’évolution du taux et du profil de la criminalité mais un produit de l’expansion externe du projet néolibéral – a reçu une validation prima facie éclatante lorsque Les Prisons de la misère a été publié dans une douzaine de langues dans les années qui ont suivi sa parution. Cette réaction fervente à l’étranger m’a donné l’occasion de parcourir trois continents pour tester dans la pratique la pertinence de ses arguments. Elle m’a permis de confirmer que la popularité mondiale du « modèle de New York » du maintien de l’ordre, incarné par son ancien chef William Bratton et par le maire qui l’avait nommé (puis démis de ses fonctions), Rudolph Giuliani, est bien la partie visible de l’iceberg d’une réorganisation plus large de l’autorité publique, un élément dans un courant plus large de transfert transnational de politiques publiques qui inclue la flexibilisation du marché du travail déqualifié et le remaniement restrictif de la protection sociale en « workfare »* sur le modèle offert par l’Amérique post-fordiste et post-keynésienne. Une récapitulation sélective de la trajectoire météorique de l’édition originale des Prisons de la misère à travers les sphères de débat et les frontières nationales peut nous aider à mieux discerner l’enjeu de la discussion intellectuelle et des luttes politiques qu’il joint, et qui ne concerne pas tant le crime et le châtiment que la réinvention de l’État visant à favoriser, puis à répondre, aux conditions économiques et socio-morales qui se cristallisent sous l’hégémonie néolibérale.
D’emblée le livre a traversé les frontières entre les sphères universitaire, journalistique, et civique. En France, Les Prisons de la misère a été littéralement lancé depuis le cœur de l’institution carcérale : un après-midi gris et froid de novembre 1999, j’ai présenté les fruits de mon enquête en direct sur Canalweb et Télé La Santé, la station de télévision interne tenue par les détenus de la maison d’arrêt de La Santé au cœur de Paris, pour ensuite en débattre à nouveau jusqu’à une heure tardive de la nuit avec les personnels et les recrues de l’Ecole nationale d’application pénitentiaire, réunis dans la salle comble de leur cafeteria située alors en lisière de la capitale. En quelques semaines, la discussion s’est étendue aux grands médias et à des lieux académiques et militants aussi divers que l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et la fête annuelle de Lutte Ouvrière, la Maison des sciences de l’homme de Nantes et un « débat de bar » tenu par Les Verts à Lyon, le Centre national pour la recherche scientifique et l’École de la magistrature, et des réunions publiques dans tout le pays organisées entre autres par les Amis du Monde Diplomatique, Amnesty International, Attac, la Ligue des droits de l’Homme, Raisons d’agir, le Genepi (une organisation étudiante d’enseignement en prison), des universités et des associations de quartier dans diverses régions, plusieurs partis politiques, et l’une des principales loges maçonniques du pays. Une rencontre publique d’une journée sur « La pénalisation de la misère », organisée à la Maison des syndicats dans ma ville d’enfance de Montpellier en mai 2000, illustre bien cet esprit de débat catholique et dynamique, qui a réuni chercheurs en sciences sociales, avocats et magistrats, militants et représentants syndicaux issus de nombreux secteurs de l’État : éducation, santé, protection sociale, protection judiciaire de la jeunesse, administration pénitentiaire [4]. Bientôt Les Prisons de la misère a été adapté pour le théâtre (et interprété sur scène aux Rencontres de la Cartoucherie en juin 2001), et ses arguments insérés dans des films documentaires (tel La Raison du plus fort), et reproduits dans des anthologies universitaires, des fanzines libertaires et des publications du gouvernement. Et j’ai été sollicité par l’Organisation Internationale du Travail pour venir le présenter au Forum 2000 des Nations Unies à Genève, où les représentants de plusieurs pays m’ont pressé de me rendre chez eux pour y ouvrir le débat de politique publique proposé par le livre.
Il m’était difficile de décliner ces invitations vu qu’en quelques mois, le livre était traduit et publié dans une demi-douzaines de pays, déclenchant un déluge d’appels provenant d’universités, de centres de défense des droits de l’homme, de gouvernements municipaux et régionaux, et de toute la gamme des organisations professionnelles et politiques désireuses de discuter de ses implications dans des nations aussi distantes et diverses que l’Italie et l’Équateur, le Canada et la Hongrie, la Finlande et le Japon. Sur la péninsule ibérique, Les Prisons de la misère fut promptement traduit non seulement en espagnol mais encore en catalan, en galicien et en portugais. En Bulgarie, mon traducteur fut invité à présenter ses arguments par la télévision nationale puisque je ne pouvais me rendre à Sofia pour le faire moi-même. Au Brésil, le lancement de Prisões da miseria, soutenu par l’Instituto Carioca de Criminologia et le mastère de droit pénal de l’Universidade Candido Mendes, fut marqué par un débat avec le ministre de la Justice et un ancien gouverneur de l’état de Rio de Janeiro, et couvert par les principaux journaux nationaux (sans doute intrigués par le titre que j’avais donné à mon allocution : « La bourgeoisie brésilienne souhaite-t-elle rétablir une dictature ? » - Wacquant, 2003 [5]) . En quelques semaines, la thèse du livre fut invoquée par des journalistes, des universitaires, et des avocats et même citée dans une décision de la Cour suprême. En Grèce, la publication du livre a ancré un colloque de deux jours co-organisé par l’ambassade de France à Athènes sur « L’État pénal aux États-Unis, en France et en Grèce » qui a réuni chercheurs en sciences sociales, juristes, historiens, fonctionnaires de la justice et nombre de journalistes. Au Danemark, une association progressiste de travailleurs sociaux a subventionné la publication de De fattiges fængsel comme munitions scientifiques dans leur résistance à la dérive bureaucratique vers la surveillance punitive des pauvres par leur profession. En Turquie, le livre a circulé par le truchement de l’école des chefs de police du pays dans une traduction non autorisée produite par un commissaire qui l’avait lu alors qu’il faisait des études de sociologie en France, jusqu’à ce qu’il soit signé pour publication dans une édition légale.
Mais c’est la visite que j’ai effectuée en Argentine en avril 2000 qui révèle le mieux à quel point le nerf sociopolitique que le livre avait touché était à vif. C’était la première fois que je me rendais dans ce pays ; je n’avais aucune connaissance préalable de ses institutions et traditions policières, judiciaires et pénitentiaires ; et pourtant tout s’est passé comme si j’avais formulé un cadre analytique conçu pour capter et éclairer les événements argentins du moment. Atterrissant à Buenos Aires dans la dernière ligne droite d’une campagne électorale municipale et régionale tendue dans laquelle les candidats de la gauche comme de la droite avaient fait de la lutte contre la criminalité grâce aux méthodes inspirées des États-Unis leur première priorité, un mois à peine après l’apôtre mondial de la « tolerancia zero », William Bratton, venu prêcher sa bonne parole policière, je me suis trouvé pris dans l’œil d’un cyclone intellectuel, politique et médiatique. En dix jours, j’ai donné vingt-neuf conférences devant des publics universitaires et militants, participé à des réunions d’expertise avec des représentants gouvernementaux et des juristes, et accordé des entretiens à toute la gamme des médias imprimés, télévisés et radiodiffusés. Une semaine à peine après mon arrivée, des passants m’arrêtaient dans les rues de Buenos Aires, brulant de me poser des questions supplémentaires sur Las Cárceles de la miseria.
L’objet de cette récapitulation n’est certainement pas de suggérer que la réception des Prisons de la misère à l’étranger donne une juste mesure de ses mérites analytiques, mais de donner une idée de la large diffusion et de la fièvre ardente que le phénomène dont il suit la trace produit dans les champs politiques, journalistiques et intellectuels des sociétés du Premier et du Deuxième monde. Une tornade sécuritaire fait bel et bien rage dans le monde entier, qui a transformé le débat et les politiques publics sur le crime et le châtiment de manières qu’aucun observateur de la scène pénale n’aurait pu prévoir une douzaine d’années auparavant. La raison de l’engouement peu commun pour mon livre à l’échelle internationale était la même qu’en France : dans tous ces pays, les slogans de la « tolérance zéro » et « la prison, ça marche », canonisés par les officiels du gouvernement américain et mis en vitrine par le duo Giuliani-Bratton comme la cause de la baisse miraculeuse de la criminalité à New York, ont été salués par les autorités du cru. Partout, les politiciens de droite et – chose bien plus remarquable – de gauche [6] , rivalisaient pour importer les méthodes américaines de maintien de l’ordre, présentées comme la panacée pour guérir la violence urbaine et les désordres qui lui sont associés, tandis que les sceptiques et les critiques de ces méthodes cherchaient des arguments théoriques, des données empiriques et des coupe-feux civiques à même de contrarier l’adoption de la contention punitive comme technique généralisée de gestion d’une insécurité sociale endémique.
Le « consensus de Washington » englobe la lutte contre la criminalité
La diffusion internationale rapide du livre s’est transformée en une expérience impromptue sur la politique de la connaissance en sciences sociales. Alors que j’avais en ligne de mire analytique le noyau central de l’Union européenne, elle a révélé que le modèle du lien entre néolibéralisation et pénalité punitive esquissé dans le livre était encore plus pertinent dans la périphérie du Vieux monde prise dans les affres de la conversion post-soviétique, et dans les pays du Second monde caractérisés par un lourd legs autoritaire, une conception hiérarchique de la citoyenneté, et une pauvreté de masse adossée à des inégalités profondes et croissantes, contextes dans lesquels la pénalisation de la misère est garanti d’avoir des conséquences calamiteuses. Vues sous cet angle, les sociétés d’Amérique latine qui s’étaient lancées dans des expériences précoces de dérégulation économique radicale (soit de re-régulation en faveur des entreprises multinationales), avant de tomber sous la tutelle des organismes financier internationaux imposant les dogmes monétaristes, offraient un terrain des plus propices à l’adoption de versions dures du populisme pénal et à l’importation des stratagèmes américains de lutte contre la criminalité. Pour le dire en une formule : les élites dirigeantes des nations séduites – puis transformées – par les « Chicago Boys » de Milton Friedman dans les années 1970 étaient vouées à s’éprendre des « New York Boys » de Rudy Giuliani dans les années 1990, lorsque le temps fut venu de contenir les conséquences ramifiantes de la restructuration néolibérale et de faire face à l’instabilité sociale endémique et aux troubles urbains bouillonnants engendrés par la « marchandisation » en bas de la structure de classe dualisée. Ce n’est pas par hasard si le Chili, qui fut le premier à adopter les politiques dictées par les « médecins de la monnaie » de l’université de Chicago (Valdés, 1984) avant de devenir le premier pays du continent en termes d’incarcération, a vu son taux d’emprisonnement grimper en flèche, de 155 détenus pour 100.000 habitants en 1992 à 240 pour 100.000 en 2004, tandis que le taux du Brésil bondissait de 74 à 183 et celui de l’Argentine de 63 à 140 (l’Uruguay, pris entre les deux, affichant une hausse de 97 à 220). Le continent tout entier est non seulement traversé par la montée d’une peur aiguë de la criminalité urbaine galopante, qui s’est accru avec les disparités socioéconomiques dans le sillage du retour à la démocratie électorale et du désengagement social de l’État, et par une préoccupation politique intense pour la gestion des territoires et des catégories à problèmes. On constate également partout l’invocation d’un même jeu de solutions punitives – élargissement des pouvoirs et prérogatives de la police qui centre son action sur les délits de rue et les infractions liées à la drogue ; accélération et durcissement des procédures judiciaires ; expansion de la prison réduite à sa fonction d’entrepôt humain, et normalisation de la « pénalité d’urgence » appliquée de façon différentielle à travers l’espace social et physique (pour une illustration colombienne, voir Iturralde, 2008) – inspirées ou légitimées par des « remèdes miracles » venus des États-Unis, du fait de l’action diligente des diplomates et des agences judiciaires américaines à l’étranger, des activités ciblées des think tanks étasuniens et de leurs alliés locaux, et de l’appétit des dirigeants politiques de ces pays pour les slogans et les mesures de maintien de l’ordre enrobés du mana de l’Amérique. Dans l’hémisphère sud comme en Europe occidentale, les think tanks ont joué un rôle-clef dans la diffusion d’une pénalité agressive « made in USA ». Dans les années 1990, le Manhattan Institute a été le fer de lance d’une campagne transatlantique qui a profondément altéré les paramètres des politiques publiques britanniques concernant la pauvreté, la protection sociale et la criminalité. Une décennie plus tard, ce même institut a monté l’Inter-American Policy Exchange (IAPE) [7], un programme conçu pour exporter ses stratégies favorites de lutte contre le crime de rue en Amérique latine comme élément d’un paquet de mesures néolibérales comprenant les « zones d’aménagement économique » (business improvement districts*), la réforme du système d’enseignement par la distribution de « bons scolaires » (school vouchers*) et l’évaluation bureaucratique, le downsizing des administrations publiques par la suppression de postes de fonctionnaires, et les privatisations. Ses principaux émissaires n’étaient autres que William Bratton lui-même, son ancien adjoint à la police de la ville de New York, William Andrews, et George Kelling, l’illustre co-inventeur de la soi-disant théorie de la « vitre brisée ». Ces missionnaires de « l’ordre sécuritaire » ont voyagé au sud, pour rencontrer non seulement les chefs de police et les maires des grandes villes mais aussi des gouverneurs, des ministres et des présidents. Appuyés par le bureau permanent de l’IAPE à Santiago du Chili, ils diffusent leur propagande par l’intermédiaire des think tanks de la droite locale, des établissements de la chambre de commerce des États-Unis dans le pays concerné, des organisations patronales et de riches donateurs privés, offrant des conférences, des réunions d’expertise politique, et participant même à des réunions publiques – Kelling est allé jusqu’à prononcer un discours remarqué à Buenos Aires devant quelque dix mille Argentins rassemblés à Luna Park pour protester contre la flambée du taux de criminalité [8]. Lorsque c’est nécessaire, l’IAPE contourne le niveau national et travaille avec des opposants régionaux ou municipaux au gouvernement central pour promouvoir leurs remèdes de marché et de police. C’est le cas au Venezuela, où le président de gauche Hugo Chávez souhaite combattre la criminalité en réduisant la pauvreté et les inégalités, alors que ses adversaires politiques, dont le maire de Caracas, partagent le point de vue du Manhattan Institute selon lequel les criminels sont seuls responsables de la criminalité et la mission de les réprimer revient exclusivement aux forces de l’ordre.
Le Manhattan Institute traduit en espagnol et en portugais ses rapports, ses dossiers politiques et les articles de presse soutenant son point de vue, et il les distribue aux « faiseurs d’opinion » dans toute l’Amérique du sud. Il organise aussi des déplacements collectifs de représentants des autorités latino-américaines à New York, avec visites sur le terrain, séances de formation, et endoctrinement intensif aux vertus de la réduction de l’État (social et économique) et du maintien de l’ordre intransigeant (pour la criminalité des classes populaires). Cette évangélisme en politique politique a « engendré toute une génération de dirigeants politiques » latino-américains « pour lesquels le Manhattan Institute est l’équivalent d’un Vatican idéologique » [9], et sa conception bifurquée du rôle de l’État, un dogme sacrosaint : « laissez-faire » et soutien en haut, intrusion et entrave en bas. Ces responsables politiques ont à cœur d’imposer un maintien de l’ordre inflexible et une incarcération accrue pour rétablir la sécurité dans les rues et contenir les troubles qui secouent leurs villes, en dépit de la corruption endémique dans la police, la banqueroute des procédures judiciaires, et la cruelle brutalité des maisons d’arrêt et des prisons de leurs pays, qui garantissent que les stratégies de mano dura se traduisent sans coup férir par une escalade de la peur du crime, de la violence, et des « détentions et peines extra-légales pour des délits mineurs, allant jusqu’à l’occupation quasi militaire et le châtiment collectif de quartiers entiers » (Dammert & Malone, 2006).
Fait remarquable, la force d’attraction de la pénalité inspirée des Etats-Unis et les profits politiques qu’elle promet sont tels que les dirigeants politiques à travers l’Amérique latine continuent de pousser pour des réponses punitives à la criminalité de rue alors même que les partis de gauche ont accédé au pouvoir et ont fait de la région « l’épicentre de la dissidence contre les idées néolibérales et de la résistance à la domination économique et politique des États-Unis » (Hershberg & Rosen, 2006, p. 432). Cette disjonction est illustrée par la signature solennelle par Andrés Manuel López Obrador, le maire progressiste de la ville de Mexico, d’un contrat de 4,5 millions de dollars (payé par un consortium de patrons du cru, avec à sa tête l’homme le plus riche d’Amérique latine, Carlos Slim Herú) avec le cabinet de conseil Giuliani Partners pour appliquer sa potion magique de la « tolérance zéro » à la capitale mexicaine, en dépit de l’inadéquation flagrante de ses mesures standard sur le terrain (Lorpard, 2003) [10]. Un exemple : les opérations visant à éliminer les vendeurs de rues et les nettoyeurs de pare-brises (des enfants pour la plupart) par des interventions policières répétées sont vouées à l’échec du simple fait de leur nombre (se comptant en dizaines de milliers) et de leur rôle central dans l’économie informelle de la ville, et par là dans la reproduction des ménages des classes populaires dont le soutien électoral est indispensable à Obrador. Sans compter que les policiers mexicains eux-mêmes sont largement impliqués dans des échanges informels de toutes sortes, légaux et illégaux, nécessaires pour compléter leurs salaires de misère. Mais qu’importe : à Mexico comme à Marseille ou à Milan, il s’agit moins d’adopter des stratégies réalistes pour réduire la criminalité que de mettre en scène la détermination des autorités à lancer une attaque frontale contre elle, de sorte à réaffirmer rituellement la fortitude du gouvernant.
La réaction internationale aux Prisons de la misère et les évolutions de la justice pénale au cours de la dernière décennie dans des pays aussi divers que la Suède, la France, l’Espagne et le Mexique ont confirmé non seulement que la Brattonmania est devenue un phénomène (presque) mondial, mais aussi que la dissémination de la « tolérance zéro » participe d’une circulation internationale plus large de formules politiques liant règne du marché, rétrécissement de la couverture sociale et déploiement du système pénal (Tham, 2001 ; Mucchielli, 2008 ; Medina-Ariza, 2006 ; Davis, 2007). Le « consensus de Washington » sur la dérégulation économique et la réduction de la protection sociale a de fait été élargi pour englober le contrôle punitif de la criminalité sur un mode pornographique et managérial, la « main invisible » du marché appelant le « poing de fer » de l’État pénal. La coïncidence géographique et chronologique de leurs trajectoires de propagation corrobore ma thèse centrale selon laquelle la montée en puissance et l’exaltation de la police, des tribunaux et des prisons dans les sociétés du Premier et du Second monde au cours des deux décennies passées sont une composante à part entière de la révolution néolibérale. Dans les périodes et les régions où celle-ci progresse sans entrave, la dérégulation du marché du travail à bas salaires nécessite la réorganisation restrictive de la protection sociale pour imposer l’emploi précaire au prolétariat post-industriel. Ces deux processus, à leur tour, déclenchent l’activation et le renforcement de l’aile pénale de l’État, d’abord pour réduire et contenir les dislocations urbaines causées par la diffusion de l’insécurité sociale au bas de la hiérarchie des classes et des places, et ensuite pour rétablir la légitimité des dirigeants politiques discrédités pour avoir organisé ou acquiescé à l’impuissance du Léviathan sur les fronts social et économique (Wacquant, 2008c). A contrario, là où la néolibéralisation a été contrariée sur les plans de l’emploi et de la protection sociale, l’élan vers la pénalisation a été coupé ou détourné, comme l’indique par exemple la surdité tenace des pays nordiques aux sirènes de la « tolérance zéro » (en dépit de leur zèle accru dans la répression des infractions liées à la drogue et de la conduite en état d’ébriété au cours de la dernière décennie) et, partant, la stagnation ou l’augmentation fort modérée de leurs populations carcérales alors même que la criminalité fait l’objet d’une attention et d’inquiétude accrues dans ces sociétés.
Les leçons des pérégrinations et des labeurs de la pénalité néolibérale
Par conséquent, Les Prisons de la misère suggère qu’il est nécessaire de compléter, voire de supplanter, les modèles évolutionnistes qui dominent les récents débats théoriques sur le changement pénal dans les sociétés avancées par une analyse discontinuiste et diffusionniste qui suive la circulation des discours, des normes et des dispositifs punitifs élaborés aux États-Unis comme ingrédients constitutifs du gouvernement néolibéral de l’inégalité sociale et de la marginalité urbaine.
Dans la vision de la « société de l’exclusion » de Jock Young et dans l’analyse de la « culture du contrôle » chez David Garland, comme dans les plus récentes conceptions eliasiennes, néo-durkheimiennes et néo-foucaldiennes de la pénalité (Young, 1999 et 2007 ; Garland, 2001 ; Pratt, 2002 ; Boutellier, 2004 ; O’Malley, 1998 ; Simon, 2007), les déplacements contemporains de la reconfiguration politique du crime et du châtiment résultent de l’avènement d’un stade sociétal – la modernité tardive, la post-modernité, la société du risque – et elles émergent de façon endogène en réaction à la montée de l’insécurité criminelle et à ses répercussions dans l’ensemble de l’espace social. Dans le modèle esquissé par Les Prisons de la misère (et révisé dans des publications ultérieures), le virage punitif de la politique publique, qui concerne à la fois la protection sociale et la justice pénale, participe d’un projet politique qui répond à la montée de l’insécurité sociale et à ses effets déstabilisateurs dans les échelons inférieurs de l’ordre social et spatial. Ce projet implique la refonte et le redéploiement de l’État pour soutenir les mécanismes de type marchand et discipliner le nouveau prolétariat postindustriel tout en contenant les perturbations internes générées par la fragmentation du salariat, la rétraction des systèmes de protection sociale, et la réorganisation corrélative de la hiérarchie ethnique établie (ethnoraciale aux États-Unis, ethnonationale en Europe occidentale, et un mélange des deux en Amérique latine - Wacquant, 2010). Mais la fabrication du nouveau Léviathan incorpore aussi les influences externes d’opérateurs politiques et d’entrepreneurs intellectuels engagés dans une campagne de marketing idéologique à plusieurs niveaux traversant les frontières nationales, et portant sur le rapport capital/travail, la protection sociale, et le maintien de l’ordre. S’il est vrai que le néolibéralisme est, depuis son origine, une formation multi-localisée, polycentrique et géographiquement inégale (Peck & Theodore, 2007), il reste qu’au tournant du siècle cette campagne de remodelage par le haut de la triade formée par l’État, le marché et la citoyenneté avait bien un centre névralgique situé aux États-Unis, un cercle rapproché de pays-collaborateurs jouant le rôle de stations-relais (tels l’Angleterre en Europe de l’Ouest et le Chili en Amérique du sud), et une périphérie de sociétés-cibles visées par des projets d’infiltration et de conquête.
Le contraste théorique entre la vision du changement pénal présentée par les tenants de l’entrée dans la modernité tardive ou la post-modernité et le modèle esquissé dans Les Prisons de la misère peut être résumé dans le tableau ci-dessous. Pour les premiers, la montée de la punitivité est une formation culturelle exprimant des dilemmes sociaux qui constitue une réplique aux tendances de la criminalité ; selon le second, la coïncidence entre la restriction de la protection sociale et l’expansion de la prison marque un déplacement de la gestion assistantielle vers la gestion pénale de la marginalité urbaine. Il fait partie intégrante de la refonte de l’État visant à promouvoir la dérégulation économique et à contenir les conséquences de la diffusion de l’insécurité sociale au bas des échelles de classe, ethnique et spatiale. Il existe bien sûr des points d’accord et de chevauchement entre ces deux approches, parmi lesquels leur rejet commun des perspectives criminologiques étroitement focalisées sur le couple « crime et châtiment », leur volonté de lier les permutations des sanctions pénales aux propriétés les plus générales des sociétés contemporaines, et l’attention qu’elles portent à la dimension culturelle de la pénalité. Néanmoins, il est utile d’insister sur leur divergence, en particulier pour ce qui concerne le rôle qu’elles accordent à la question de la pauvreté et de la précarité, à l’hégémonie internationale, et aux opérateurs transnationaux dans la réorganisation du discours et de l’action dans le domaine pénal au seuil du nouveau siècle.
| Modernité tardive/postmodernité (Young, Garland, Pratt, Simon) | Néolibéralisme (Wacquant) | |
| Moteur | stade sociétal : modernité tardive, post-modernité, société du risque | projet politique : néolibéralisme comme refonte de l’État |
| Origine | endogène : évolution | mixte : évolution et diffusion (opérateurs transnationaux) |
| Déclencheur | insécurité criminelle : taux et composition des infractions | insécurité sociale : fragmentation du salariat et ses conséquences |
| Véhicules | politiques de lutte contre la criminalité et culture du maintien de l’ordre | Workfare* et prisonfare* combinés |
| Cibles | distribuées dans l’ensemble de l’espace social | échelons inférieurs des échelles de classe, ethnique et spatiale |
À de rares exceptions près, les spécialistes américains de la politique pénale ont ignoré les ramifications à l’étranger des schémas policiers, judiciaires et carcéraux élaborés par les États-Unis en réaction au rejet du compromis fordiste-keynésien et à l’effondrement du ghetto noir – quand ils n’en nient pas carrément l’existence [11]. Pourtant, la prise en compte de cette dissémination par-delà les frontières, qui a apporté jusqu’au cœur de l’Europe non seulement la police de tolérance zéro, mais aussi les couvre-feu et la surveillance électronique, les camps de redressement pour jeunes et l’incarcération préventive « de choc », le plaider coupable et les peines planchers, les dispositifs d’enregistrement des ex-délinquants sexuels et la diversion des mineurs devant la justice pour adultes, est indispensable à l’élucidation des enjeux analytiques et politiques de la pénalité néolibérale. Tout d’abord, elle révèle les liens directs entre la dérégulation du marché du travail, la réduction de la protection sociale et l’expansion pénale en attirant l’attention sur leur diffusion conjointe et séquentielle d’un pays à l’autre. Il est révélateur, par exemple, que le Royaume-Uni ait adopté en premier lieu la politique de flexibilisation du travail, puis le schéma du workfare obligatoire innové par les États-Unis, avant d’importer les idiomes et les programmes agressifs de lutte contre la criminalité développés outre-Atlantique afin de mettre en scène l’intransigeance morale et la sévérité pénales renaissantes des autorités (King & Wickham-Jones, 1999 ; Peck & Theodor, 2001 ; Jones & Newburn, 2002).
Ensuite, suivre la circulation internationale des formules pénales « made in USA » permet d’éviter le piège conceptuel de l’exceptionnalisme américain ainsi que les dissertations vagues sur la « modernité tardive » en pointant les mécanismes qui propulsent la montée de l’État pénal – ou les obstacles institutionnels et les vecteurs de résistance qui la freinent, le cas échéant – dans un spectre de sociétés soumises au même tropisme politico-économique. Cela nous conduit à concevoir le gonflement du bras pénal aux États-Unis non comme un phénomène idiosyncrasique mais comme un cas particulièrement virulent, en raison d’une constellation de facteurs qui se combinent pour faciliter, accélérer et intensifier la contention punitive de l’insécurité sociale dans cette société : inter alia, la fragmentation extrême du champ bureaucratique, la force de l’individualisme moral soutenant le principe mantrique de la « responsabilité individuelle », la dégradation généralisée du travail, l’intensité inhabituellement élevée de la ségrégation ethnique et de classe, et le caractère saillant et rigide de la division ethnoraciale qui fait des Noirs des classes populaires enfermés dans l’hyperghetto en désagrégation des cibles toutes indiquées pour les campagnes convergentes de contraction de la protection sociale et d’escalade pénale (Wacquant, 2008d et 2010).
Enfin, une relation de causalité rétroactive existe entre l’innovation et l’émulation en matière de politique publique au niveau local (municipal ou régional), national et international, de sorte que retracer la mondialisation de la « tolérance zéro » et du slogan « la prison, ça marche » ouvre une voie fructueuse pour disséquer les processus de sélection et de re-traduction de notions et de mesures pénales à travers les juridictions et les niveaux de gouvernement, processus qui passent généralement inaperçus ou échappent à l’analyse conduite à l’intérieur d’un pays donné. Cette approche transnationale offre des aperçus inédits sur la fabrication de la vulgate néolibérale qui règne aujourd’hui partout, et qui a partout transformé les débats politiques par le biais de la diffusion planétaire des concepts et préoccupations indigènes des décideurs et des universitaires des États-Unis : en exportant ses théories et ses politiques pénales, l’Amérique s’est érigé en baromètre de la lutte contre le crime dans le monde entier et a de fait légitimé sa conception du maintien de l’ordre en universalisant ses particularismes [12]. Suivre la diffusion des slogans et des mesures de la pénalité fabriquée aux États-Unis au travers des frontières soulève également de façon aiguë la question des bases sociales et culturelles de la résistance politique à la punitivité : comment l’Allemagne et la Scandinavie en Europe occidentale, le Canada en Amérique du Nord et le Japon en Extrême-Orient sont-ils parvenus à demeurer imperméables ou réticents à l’appel à intensifier les châtiments et à élargir l’emprisonnement ? Est-ce simplement qu’ils se sont moins avancés sur la voie de la dérégulation économique, des disparités de classe et de la paupérisation urbaine, ou sont-ils en retard dans la transition de la supervision sociale à la supervision pénale de la pauvreté ? Ou bien présentent-t-ils des combinaisons spécifiques de formes de contrôle social rapproché, de valeurs culturelles, d’organisation bureaucratique, d’autorité des experts, et d’engagement civique en faveur de l’inclusion sociale qui leur permet de détourner les pressions à l’incarcération accrue, comme l’illustre la récente trajectoire du Japon ? (Johnson, 2007)
En tant que première monographie consacrée à la diffusion transnationale du modèle étasunien de pénalité à la fin du siècle, Les Prisons de la misère annonçait l’éclosion du champ d’étude des « transferts de politiques publiques » en matière policière et judiciaire (voir en particulier Newburn & Sparks, 2004 ; Jones & Newburn, 2006 ; Muncie & Goldson, 2006 ; Andreas & Nadelmann, 2006). En cela, le livre est une contribution indirecte aux recherches sur la mondialisation de la criminalité et de la justice prise du point de vue du châtiment, mais une contribution qui va à contre-courant des études sur la « globalisation » dans la mesure où elle affirme que ce qui prend des allures de glissement spontané et bénin vers une convergence planétaire, supposément engendrée par l’unification technologique et culturelle de la sphère politique du monde, est en réalité un processus stratifié d’américanisation différenciée et diffractée, favorisée par les activités stratégiques de réseaux hiérarchisés de décideurs d’État, d’entrepreneurs idéologiques, et de marketeurs universitaires aux États-Unis et dans les pays de réception. Elle appelle également les chercheurs qui travaillent sur les migrations des politiques publiques sur la scène mondiale à faire entrer le domaine pénal dans leur champ d’investigation, aux côtés des politiques économiques et sociales, et à prêter attention au rôle moteur joué par les think tanks, ainsi que par les disciplines et les chercheurs hétéronomes, dans les pérégrinations internationales des formules d’action gouvernementales [13] .
Le parcours des Prisons de la misère à travers les frontières nationales, comme le mouvement de la vague punitive qu’il suit, m’ont appris que la diffusion de la pénalité néolibérale est, non seulement plus avancée, mais aussi plus diversifiée et plus complexe qu’elle n’est décrite dans le livre. De même qu’il existe des « variétés » de capitalisme, il existe des voies multiples vers l’empire du marché, et donc autant de chemins possibles vers la pénalisation de la pauvreté. La pénalisation elle-même prend une multiplicité de formes, qui ne se limitent pas à l’incarcération (en Europe, elle prend plutôt la forme de la « policiarisation », comme en atteste le doublement du nombre de gardes à vue en France depuis 2002). Elle produit des effets variables en passant par le filtre des différentes subdivisions des appareils policier, judiciaire et pénitentiaire. Elle s’infiltre dans les divers domaines de la politique étatique, s’immisçant dans la distribution d’autres biens et services publics tels que la santé, la protection infantile et le logement social. Et elle suscite communément des réticences, rencontre souvent des résistances, et déclenche parfois des contre-attaques vigoureuses [14]. De plus, les composantes matérielles et discursives des politiques pénales peuvent se « découpler » et voyager séparément, ce qui conduit à une accentuation hyperbolique de la vocation symbolique du châtiment comme instrument de catégorisation et de marquage des frontières. Autant de points qui nécessitent d’amender et d’étoffer le modèle rudimentaire des interconnexions entre néolibéralisme et pénalité punitive esquissé dans Les Prisons de la misère.
Telle est la tâche entreprise dans Punishing the Poor : The Neoliberal Government of Social Insecurity (Wacquant, 2009). Ce livre rompt avec les paramètres conventionnels de l’économie politique du châtiment en intégrant les évolutions de la protection sociale et de la justice pénale dans un même cadre théorique accordant une attention égale aux moments instrumental et expressif de la politique publique. Il adopte et adapte le concept de « champ bureaucratique » de Pierre Bourdieu pour montrer que les transformations des politiques sociales et pénales dans les sociétés avancées au cours du dernier quart de siècle sont réciproquement liées (Bourdieu, 1993) ; que le workfare avaricieux et le prisonfare dispendieux tendent à former un seul et même dispositif organisationnel pour discipliner et superviser les pauvres sous l’égide de la philosophie du behaviorisme moral ; et qu’un système pénal expansif et coûteux n’est pas une simple conséquence du néolibéralisme – comme je l’avançais dans Les Prisons de la misère – mais bien une composante à part entière de l’État néolibéral lui-même. Le déploiement d’une police zélée, d’une justice intransigeante et d’une prison bouffie ne constitue pas une violation, ni une déviation, du néolibéralisme –bien au contraire : elle en est l’indispensable vecteur dans la mesure où l’État s’appuie sur la pénalisation comme technique de gestion de la pauvreté urbaine et de la marginalité sociale galopantes qu’il génère dès lors qu’il dérégule l’économie et racornit la protection sociale. Contre la conception « fine », étroitement économique du néolibéralisme comme simple empire du marché, qui participe de l’idéologie néolibérale, je propose une caractérisation sociologique « épaisse » du néolibéralisme réel qui articule quatre logiques institutionnelles : la marchandisation, la surveillance disciplinaire par le biais du workfare, un État pénal activiste et le trope culturel de la « responsabilité individuelle ». Les labeurs contemporains de la pénalité s’avèrent relever d’un processus plus large de remodelage et de remasculinisation de l’Etat qui ont rendue obsolète la séparation conventionnelle, dans la recherche comme dans le débat de politique publique, entre protection sociale et justice pénale. Les institutions policière, judiciaire et carcérale ne sont pas de simples outils techniques avec lesquels les autorités réagissent à la criminalité – comme le voudrait la conception de sens commun consacrée par le droit et la criminologie – mais des capacités politiques essentielles par le truchement desquelles le Léviathan entend tout à la fois produire et administrer l’inégalité, la marginalité et les identités, mais aussi signifier sa souveraineté. Autant de missions qui pointent la nécessité de développer une sociologie politique du retour de l’État pénal sur le devant de la scène historique à l’aube du XXIe siècle, projet intellectuel auquel Punishing the Poor contribue et invite à la fois [15].
NB : Cet article s’appuie sur la postface à l’édition étasunienne (révisée et augmentée) des Prisons de la misère, Prisons of Poverty (University of Minnesota Press, 2009). La traduction de l’anglais est de Mathieu Bonzom. [revisé LW 14 mai 2010]
Lexique
*Business improvement districts : cette notion renvoie à une politique de zones de partenariats public-privé au bénéfice des entreprises implantées dans les centres-villes des métropoles des États-Unis. Elle permet à ces entreprises de bénéficier de services collectifs renforcés (nettoyage, sécurité, mobilier urbain, marketing, etc.) améliorant la « qualité de vie » environnante en contrepartie de taxes spéciales.
*Prisonfare : construite par analogie avec la notion expansive de “welfare” (programmes d’aide sociale ciblés sur les pauvres dépendants, tendant à les stigmatiser et les discipliner), je désigne par “prisonfare” l’ensemble des dispositifs par lesquels l’Etat donne une réponse pénale aux désordres matériels et moraux causés par la diffusion de l’insécurité sociale et de la marginalité urbaine, ainsi que l’imagerie collective, les discours et les savoirs experts qui se cristallisent autour du déploiement corrélatif de la police, la justice et la prison et leurs extensions. La pénalisation, la socialisation et la médicalistion représentent ici trois stratégies alternatives de « traitement &r
Aucun commentaire
